Programmation 2008-2010
Découvrez la programmation scientifique et culturelle des années 2008-2010, avant l'ouverture de la BULAC.

Conférence d'Éric Meyer, vice-président de l'Inalco, Un Orient, des Orients ; une Inde, des Indes, le 11 février 2008 (Elie Jorand / BULAC).
Salon du livre de Paris 2010 : les collections de la BULAC se dévoilent...
En écho au Salon du livre de Paris 2010, les professionnels de la BULAC vous proposent une déambulation dans les œuvres de quelques écrivains étrangers prestigieux de passage dans la capitale entre le 26 et le 31 mars.
Cette actualité culturelle cosmopolite est aussi une occasion de lever un coin du voile sur les fonds arabe, chinois, indien, russe et ukrainien, en cours de constitution. L’ensemble des collections seront accessibles aux différents publics de la BULAC, dès la rentrée 2011, rue des Grands-Moulins (Paris XIIIe).
Dossier coordonné et édité par Clotilde Monteiro
Alaa Al-Aswany
Un public nombreux devrait se bousculer pour venir écouter Alaa al-Aswany au Salon du livre de Paris. L’auteur du roman phénomène L’immeuble Yacoubian, vendu à deux millions d’exemplaires à travers le monde, a été sacré par l’ensemble de la critique « digne successeur du grand Naguib Mahfouz ».
Alaa el Aswany (autre orthographe : Alla El-Aswany), à l’instar de certains écrivains étrangers invités au Salon du livre de Paris, a dû composer avec la censure dans son pays. Un des textes du recueil J’aurais voulu être Égyptien (Actes Sud 2009) lui a valu à trois reprises d’être interdit de publication par l’Office du livre pour cause d’« insulte à l’Égypte » durant les années 1990. Cet écrivain, dentiste de son métier, peut donc s’enorgueillir du succès de L’Immeuble Yacoubian (Actes Sud 2006) au regard de ces démêlés passés avec le gouvernement égyptien. D’autant que son roman est devenu un best-seller dont les ventes se chiffrent aujourd'hui à deux millions d'exemplaires. Le succès critique et populaire qui ne s’est pas démenti s’est propagé bien au-delà des frontières de l’Égypte et du monde arabe. L’immeuble Yacoubian, traduit dans une trentaine de langues depuis sa parution au Caire en 2002, s’est imposé sur la scène littéraire et médiatique internationale comme un livre phénomène. Auréolé de ce triomphe, il a été adapté au cinéma sous le titre éponyme par l’Égyptien Marwan Hamed (Omaret Yakobean, Égypte, 2006).
Ce succès planétaire n’est pas venu modifier les convictions de son auteur, qui s’autoproclame indépendant des partis politiques. Il est un des cofondateurs de Kifaya (Ça suffit), un mouvement d'opposition qui prône des élections présidentielles libres en Égypte. Il se considère aussi, aux plans intellectuel et politique, proche du grand écrivain Sonallah Ibrahim, emprisonné pour ses écrits dans les années 1960 en Égypte.
Mais Alaa al-Aswany n’est pourtant pas un artiste engagé au sens courant du terme. Bien qu’il aborde de front dans son roman la corruption, la prostitution, l’homosexualité ou les problèmes religieux, son écriture emprunte les sentiers balisés et banalisés de la narration romanesque. Et c’est dans une forme narrative où rebondissements et situations rocambolesques sont légion que l’auteur met au jour les contradictions d’une société égyptienne à la dérive. Ses personnages, qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ses concitoyens, résident dans l’immeuble Yacoubian. Un somptueux bâtiment d’une splendeur surannée, vestige d’un passé glorieux, réellement situé dans la rue Soliman-Pacha au cœur du Caire. Une rue grouillante où boutiques, bars et cinémas se disputent le chaland.
Ici, pas d’ambiance façon gated communities, l’atmosphère balance entre convivialité et promiscuité suivant les moments du jour ou de la nuit. Les nantis qui occupent dans les étages les appartements les plus spacieux cohabitent avec les plus modestes entassés sur la terrasse de l’immeuble. Athées, fervents, femmes voilées, jeunes filles stylées mais fauchées, rentiers libidineux et artisans peu scrupuleux se côtoient avec plus ou moins de bonheur. Alaa al-Aswany, qui fait fi de tous les tabous, décortique dans ce roman les nombreuses façons dont les plus faibles se débattent dans un système dans lequel ils comptent pour du beurre.
L’auteur s’intéresse notamment au jeune Taha, étudiant exemplaire et brillant issu d’un milieu si modeste qu’il n’aura pas accès au diplôme qu’il mérite. Cette injustice patente et d’autres traumatismes irréversibles entraînent le jeune homme vers une radicalisation de sa pratique de l’islam, jusqu’au point de non retour. Conseillé par un Cheikh peu recommandable, il finira par intégrer un camp d’entraînement pour assouvir son désir de vengeance envers ce régime corrompu…
Espérons que le succès planétaire de L’Immeuble Yacoubian rejaillira sur la scène littéraire égyptienne. Car l’unique prix Nobel de littérature du monde arabe, Naguib Mahfouz, disparu en 2006, demeure l’arbre qui cache la forêt. N’est-ce pas d’ailleurs à cette figure tutélaire qu’Alaa al-Aswany n'a de cesse d'être comparé par l’ensemble de la critique ?
C. M.
« Les bibliothèques sont le symbole d’une ouverture au monde »
L’écrivain Alaa al-Aswany, de passage à Paris à l’occasion du Salon du livre, nous parle de la censure, du contexte éditorial actuel en Égypte et de la relation qu’il entretient avec les bibliothèques.
À propos de la censure en Égypte…
Alaa al-Aswany : Depuis 1976, il n’existe plus de censure officielle pour les publications littéraires en Égypte. En revanche, l’Office du livre, qui est l’organe d’édition du gouvernement, contrôle scrupuleusement et peut interdire l’entrée dans le pays des livres en provenance de l’étranger. La censure officielle exerce actuellement un droit de regard sur la publication des essais sur la religion et des écrits autour du cinéma, du théâtre et de la télévision. Et celle-ci est redoutable. Il est important de préciser que durant les années 1980 et 1990, le milieu de l’édition a traversé une période de crise telle qu’il était devenu presque impossible de se faire publier par des maisons d’édition privées. Les écrivains étaient de fait contraints de passer par l’Office du livre.
Vous avez pourtant été censuré pour vos écrits dans les années 1990 ?
J’ai, en effet, rencontré des problèmes sérieux lorsque j’ai voulu publier mon premier roman Celui qui s’est approché et qui a vu, que l’on trouve dans le recueil J’aurais voulu être Égyptien paru en français chez Actes Sud. J’ai essuyé trois refus consécutifs de la part de l’Office du livre, en 1990, 1994 et 1998. Mes interlocuteurs, qui n’avaient aucune compétence en matière de littérature, faisaient un amalgame entre les propos véhéments du personnage envers son pays, l’Égypte, et l’auteur du livre. J’ai tenté d’expliquer sans aucun succès à ces personnes la différence et la distance qui existent entre un auteur et les propos qu’il met dans la bouche de ses personnages.
Dans quelles conditions L’Immeuble Yacoubian a-t-il été publié ?
Pour ne pas être sous le contrôle de l’Office du livre égyptien, j’ai cherché et trouvé un éditeur prêt à me publier au Liban. Mais des amis m’ont déconseillé de publier à l’étranger car ils étaient convaincus que mon livre ne pourrait jamais entrer ensuite sur le territoire égyptien. J’ai donc fini par trouver au Caire un écho chez Merit, une maison d’édition d’avant-garde, indépendante qui fait des choix courageux. Après avoir lu L’Immeuble Yacoubian, l’éditeur de cette maison s’est montré déterminé à le publier. Et le livre a été d’emblée protégé par son succès puisque celui-ci a été presque immédiat.
Le contexte actuel est-il plus favorable aux écrivains et à la littérature ?
En effet, car le contexte a changé depuis le début des années 2000. Désormais, les Égyptiens achètent et lisent des livres, contrairement à l’idée reçue qui persiste en Occident selon laquelle la lecture serait réservée à une élite en Égypte. Le milieu de l’édition est par conséquent moins frileux et il est devenu très volontariste puisqu’il y a une réelle demande du public. Je sais que le succès de L’Immeuble Yacoubian n’est pas étranger à ce changement, je suis donc fier d’y avoir contribué.
Pourquoi le droit d’auteur reste-t-il insuffisant selon vous en Égypte ?
Le régime actuel ne veut pas faire en sorte que les écrivains soient mieux protégés. Leur conférer des droits supplémentaires aurait pour conséquence de leur permettre d’acquérir une autonomie. Ce qui reviendrait, de fait, pour le gouvernement à perdre le contrôle sur les auteurs et aussi à avoir des devoirs envers eux. La grande majorité des écrivains dépendent totalement de l’État qui les publie et les rémunère. Pour ma part, j’ai accès aux chiffres de ventes de mes livres car j’ai une relation de confiance avec mon éditeur. Mais c’est une situation très exceptionnelle.
Quelle relation entretenez-vous avec le monde des bibliothèques et que pensez-vous de la bibliothèque d’Alexandrie ?
Les bibliothèques sont le symbole d’une certaine ouverture au monde et à la connaissance. Je suis régulièrement sollicité pour participer à l’inauguration de bibliothèques qui s’ouvrent dans mon pays. Je tiens à soutenir chacune d’entre elles car une bibliothèque est pour moi un lieu de vie aux valeurs humanistes, qu’elle soit à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Hélas, la façon dont fonctionne la Bibliothèque d’Alexandrie me rend très critique. La mainmise de l’État sur cette institution en fait un vulgaire instrument de propagande. On aurait dû laisser la possibilité à ce projet d’envergure passionnant de s’autonomiser pour devenir réellement un des phares intellectuels de notre pays.
Travaillez-vous systématiquement en bibliothèque pour écrire vos romans ?
J’effectue bien sûr toujours mes recherches en bibliothèque en amont d’un projet d’écriture. Je dois souvent réunir des informations sur lesquelles j’ai besoin de m’appuyer pour construire mes romans. Mais j’avoue que quand je passe à la phase d’écriture, je suis contraint d’abandonner l’univers studieux de la bibliothèque car j’écris en fumant. Ce qui est interdit dans ce genre de lieux publics…
Vous faites souvent référence en parlant d’engagement à l’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim. Est-il pour vous un modèle ?
En effet, je pense avoir la même conception que lui du rôle que doit jouer un écrivain dans notre société. Je suis incapable d’écrire des romans dont le propos ferait abstraction de ce qui se joue dans la rue, sous mes fenêtres pendant que j’écris. J’ai la conviction intime que la littérature par nature doit défendre des valeurs humanistes. C’est pourquoi, en tant qu’intellectuel, sans me mêler directement de politique, je participe à la vie citoyenne de mon pays pour réclamer plus de démocratie. J’estime que c’est un des rôles que doivent jouer les intellectuels dans la cité.
Comment vivez-vous le fait d’être sans cesse comparé au grand Naguib Mahfouz, l’unique prix Nobel de littérature de langue arabe ?
Je suis évidemment très honoré que mon nom soit lié à celui du grand Naguib Mahfouz. Je le considère, moi aussi, comme un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et d’ailleurs, je reste convaincu que s’il n’avait pas été arabe, il aurait certainement pu obtenir ce prix dans les années 1950, car son œuvre le méritait déjà. Mais les membres du jury du prix Nobel, qui sont de culture occidentale, ne regardent pas toujours du côté du monde arabe, loin s’en faut. C’est ce qui explique à mon sens que Naguib Mahfouz ait dû attendre 40 ans pour être enfin reconnu comme un des grands écrivains du patrimoine mondial.
Propos recueillis par C. M., le 26 mars 2010
– L’Immeuble Yacoubian, Actes Sud 2006
– Chicago, Actes Sud 2007
– J’aurais voulu être Égyptien, Actes Sud 2009
Tous ces ouvrages sont traduits en français par Gilles Gauthier.
Yan Lianke
Un temps interdit de sortie du territoire chinois (l’auteur s’est notamment vu interdire de faire partie de la délégation chinoise officielle à la Foire du Livre de Francfort), Yan Lianke est cette année l’invité du salon du livre de Paris. Outre des séances de dédicace et une lecture de son ouvrage Les jours, les mois, les années, l’auteur participera à deux débats, dont les intitulés suffisent à annoncer la couleur de ses écrits : « Briser les conventions littéraires », le 28 mars et « L’exil ou la censure », le 29 mars
Dans ce roman poignant censuré par le gouvernement chinois, Yan Lianke dénonce les ravages causés par le commerce du sang contaminé. Le narrateur est un enfant victime du sida, il nous fait part depuis l’au-delà d’une réalité indicible.
Avec ce roman paru en Chine en 2006, Yan Lianke est le premier auteur de fiction à oser dépeindre les ravages causés dans les campagnes chinoises par le commerce du sang contaminé. L’onirique, l’absurde et le tragique s’y mêlent pour évoquer à mots couverts une réalité insupportable, dont le gouvernement chinois peine à prendre la pleine responsabilité. Le narrateur, un jeune enfant mort empoisonné, prête sa voix innocente au récit bouleversant des tribulations d’un village touché de plein fouet par les ravages du sida. Son père a fait fortune en spéculant sur le sang de ses voisins, provoquant l’infection d’un grand nombre d’entre eux. Ceux-ci cherchent alors à se venger, causant ainsi la mort de son fils unique, qui nous conte depuis l’au-delà la lutte quotidienne d’un village qui se bat contre l’angoisse de la maladie et de la mort. Dans ce récit poignant, Yan Lianke dénonce la tragédie de l’hécatombe causée par le sida dans le sillage des campagnes de vente du sang encouragée par le gouvernement ; il y pose un regard également douloureux sur les extrêmes auxquels la pauvreté et la course à la richesse conduisent ses concitoyens, faisant écho au roman de Yu Hua, Le vendeur de sang.
Malgré tout, une lueur humaniste traverse le roman, un hymne à la vie et à l’amour tout aussi poignant que le portrait cruel des effets de la maladie. Enfin, à travers l’échec de la tentative d’organisation sociale que les villageois contaminés cherchent à mettre en place sur le modèle d’une société collectiviste évoquant la Chine maoïste, l’auteur évoque le triomphe d’une bureaucratie stérile sur l’utopie sociale. Mais l’ouvrage fut avant tout censuré pour ce qui fut perçu par les autorités comme une exagération des effets du sida, susceptible de provoquer le trouble dans l’esprit de la population. Rien d’exagéré, pourtant, dans les écrits de l’auteur, qui se base sur trois années d’enquête dans un village du Henan, l’une des provinces de Chine les plus ravagées par le sida. Yan Lianke avoue au contraire avoir passé sous silence les détails les plus révoltants d’une réalité intolérable, afin de passer la censure et d’alerter l’opinion sur un sujet encore extrêmement sensible. Peine perdue…Un roman magnifique et courageux, souvent comparé à La Peste de Camus.
Soline Suchet, responsable des collections chinoises
Trad. du chinois par Claude Payen. Arles : Editions Philippe Picquier, 2006. Rééd. trad. du chinois par Claude Payen, Arles : Editions Philippe Picquier, 2009
Éléments de biographie
Yan Lianke, qui avait fui la misère paysanne en s’engageant dans l’Armée populaire de libération à l’âge de 20 ans, est devenu depuis un des écrivains les plus influents de Chine malgré ses fréquents démêlés avec la censure.
Désormais reconnu en France, grâce notamment aux éditions Philippe Picquier qui ont publié en octobre dernier un cinquième titre de l’auteur, Bons baisers de Lénine, Yan Lianke est l’un des écrivains contemporains les plus influents et controversés de Chine. Maître d’un style où l’absurde se mêle au tragique pour décrire une réalité souvent douloureuse, l’auteur ne laisse pas de faire débat. Trois de ses livres ont connu la censure : un premier ouvrage, paru en 1994 et non encore traduit en français (ce qui n’a pas empêché l’ouvrage de recevoir un prix littéraire, comme l’ensemble des récits censurés de l’auteur), «夏日落 » (Couchant de soleil estival), un court roman d’une drôlerie iconoclaste, Servir le peuple, et l’un de ses récits les plus poignants, Le Rêve du Village des Ding, parus chacun en France en 2006.
Pour comprendre l'attention portée par la censure aux ouvrages de Yan Lianke, il faut chercher du côté du regard satirique et sans complaisance que l'auteur pose sur la société chinoise. Au travers de son écriture, l’absurde et l’anticonformisme mettent à nu une réalité parfois amère. Bien que l'écrivain n’attaque jamais de front le régime politique, ses récits tournent en dérision les bases sur lesquelles le gouvernement fonde « l’orgueil national » : satire de l’armée et de la bureaucratie, parodie de l’héritage maoïste, description de la misère paysanne, évocation de sujets tabous, tels que les ravages du sang contaminé, etc. De quoi, de l’avis de ces censeurs, mettre en péril « la stabilité et l’unité nationales », en semant le trouble et le mensonge au cœur des esprits.
Ironie du sort que ces démêlés avec la censure, lorsqu’on sait que l’auteur, pour fuir la misère paysanne de sa province natale — le Henan —, s’engagea dans l’armée à l’âge de 20 ans. Très vite ses talents d'écriture lui valurent d’être employé comme écrivain de propagande au service de l’Armée populaire de libération (APL), où ses écrits patriotiques reçurent plus d’un prix littéraire. Ceci, alors qu’à la ville Yan Lianke commençait de publier des satires remarquées. En 1994, paraît Couchant de soleil estival, où il décrit les démêlés de carrière peu glorieux de militaires de l’APL. L’ouvrage est censuré, son auteur surveillé de près, pendant six mois et contraint de rédiger son autocritique. Il demeura pourtant encore dix ans dans l’armée, qu’il devra quitter après la parution de Bons baisers de Lénine, roman dont le fond fut jugé irrévérencieux et l'écriture trop anticonformiste. Les années suivantes, l’auteur publiera coup sur coup Servir le peuple et le Rêve du village des Ding, à leur tour censurés et retirés de la vente.
Aujourd’hui enseignant de littérature à l’université du Peuple de Pékin, Yan Lianke pose un regard mitigé sur la création littéraire contemporaine en Chine, jugeant que nombre d’auteurs écrivent davantage par souci commercial que par engagement social ou politique. La censure fait en effet peser un risque financier que peu d'entre eux peuvent se permettre d’encourir. C’est au final l’autocensure qui semble causer le plus de ravages. La censure gouvernementale qui est moins systématique qu’autrefois, au terme de soixante ans de conditionnement des esprits, fait partie intégrante de l’inconscient des auteurs. Yan Lianke lui-même admet qu’il est fort difficile de s’en délivrer puisqu’il n’y a pas échappé. Il avoue, en effet, n’avoir pas osé transcrire la réalité crue des sinistres causés par le sida, préférant recourir aux détours de la fiction dans l’espoir de voir son ouvrage passer au travers des mailles du filet. En vain.
Soline Suchet
Dans ses écrits où le tragique rivalise avec l’absurde, Yan Lianke est dans une quête sans répit de la vérité. Cette démarche littéraire ambitieuse a été saluée par de nombreux prix et ne l’empêche pas de connaître un véritable succès en Chine, à Taïwan, Hong Kong ainsi qu’à l’étranger, où son œuvre est traduite dans une dizaine de langues.
Malgré ses nombreux démêlés avec la censure, l’auteur ne fait pas profession de défier ses agents. Son œuvre ne cherche pas tant à provoquer qu’à s’inscrire dans le rôle que Ba Jin (Plus connu par le lectorat français sous la transcription Pa Kin) confie à la littérature, celui de dire la vérité. En dépit d’une écriture empreinte d’absurde et d’onirisme, Yan Lianke est avant tout soucieux de rendre justice à cette vérité. Sans jamais extrapoler, ses récits se fondent au contraire sur son expérience personnelle. L’évocation tout à la fois poétique et douloureuse de l’indigence paysanne, notamment dans Les jours, les mois, les années et Poil de cochon (nouvelle traduite dans le recueil Amour virtuel et poil de cochon : cinq nouvelles de la Chine d’aujourd’hui, trad. par Henri Gaubier, [Paris] : Éditions des Riaux, impr. 2006), prend racine dans une jeunesse vécue au sein d’un village pauvre du Henan, l’une des provinces les plus déshéritées de Chine ; son portrait parodique de l’armée, doublé d’un pastiche de la propagande maoïste dans Servir le peuple, s’inspire de la propre carrière de paysan-soldat de l’auteur engagé comme écrivain de propagande. Au bout du compte, au travers de récits où le tragique rivalise avec l’absurde, se dessine avant tout le souci de décrire de façon détournée une réalité émouvante et inquiétante : celle des tropismes d’une société chinoise qui se débat dans ses contradictions. Son évocation tendre, satirique et pourtant douloureuse de ses contemporains est présente dans chacun de ses récits, censurés ou non. En toile de fond, s'y discerne une interrogation inquiète sur l’avenir d’une Chine entraînée dans une course à l’enrichissement où elle risque de perdre son âme.
Il faut croire que cette inquiétude trouve écho auprès des lecteurs et critiques chinois puisque les ouvrages de l’auteur connaissent un véritable succès en Chine, comme à Taïwan ou Hong Kong. Ils ont reçu une vingtaine de récompenses littéraires, dont deux des prix continentaux les plus prestigieux — le prix Lao She pour Bons baisers de Lénine, l’ouvrage même qui le fit limoger de l’armée, et le prix Lu Xun pour Les jours, les mois, les années - ainsi que le prix très populaire de la revue Asia Weekly pour Le Rêve du Village des Ding. Son succès gagne également l’étranger, où ses ouvrages sont traduits dans plus d’une dizaine de langues.
Pourtant ses récits ne sont pas sans faire débat dans les cercles littéraires, autant pour leur forme que pour leur fond. En effet, les thèmes abordés par l’auteur ne font pas sa seule originalité : lorsqu'on lui pose la question : « Selon vous, un roman politiquement subversif doit-il être également subversif littérairement ? », l’auteur répond aussitôt : « Je suis tout à fait d’accord avec cette idée! Il y a une convergence entre le politique et le littéraire » (entretien entre l’auteur et Bernard Quiriny, rapporté sur le site du Magazine Littéraire). Sa plume acérée à l’imagination fertile contribue à renverser aussi bien conventions littéraires que tabous sociaux, naviguant du lyrisme au prosaïsme, de l'onirisme au réalisme, et de l'absurde au tragique, au gré de récits non linéaires. Si c'est l’absurde qui domine, loin d’être le signe d’une déconnexion avec la réalité, celui-ci se place au contraire au service d’une vérité souvent indicible. Cette audace littéraire n’est pas venue de soi : l’auteur confesse avoir d’abord écrit dans l’espoir d’échapper à la misère, jusqu’à ce que la maladie bouleverse sa manière de voir les choses. Désormais, colère et passion sont l'âme de son travail, et celles-ci s’expriment aussi bien au travers des réalités abordées que par l’originalité d’un style composite très personnel.
Soline Suchet
- Servir le peuple
Cette novella iconoclaste raconte, sur un air de Lady Chatterley, les amours illicites entre l’épouse sensuelle d’un commandant impotent et le jeune soldat attaché aux tâches domestiques. Derrière ce récit adultérin, Yan Lianke tourne en dérision la propagande maoïste. Le signal des ébats frauduleux des deux héros n’est autre qu’un panneau de bois portant le slogan « Servir le peuple », l’une des plus célèbres formules de Mao Zedong. De même que lorsque la fièvre amoureuse commence de s’épuiser, nos deux tourtereaux découvrent avec émoi que le saccage des symboles maoïstes (bustes, slogans, etc.) décuple leur ardeur. Au-delà de la satire de la confiscation des idéologies au profit de l'intérêt personnel, l’auteur dénonce l’impunité des cadres de l’armée. Un bijou d’insolence, condamné par la censure pour son « érotisme débordant » et sa parodie de l’héritage maoïste.
Trad. du chinois par Claude Payen. Arles : Éditions Philippe Picquier, 2006.
- Les jours, les mois, les années
Une terrible sécheresse contraint la population d'un petit village de montagne à fuir vers des contrées plus clémentes. Incapable de marcher des jours durant, un vieil homme demeure, en compagnie d'un chien aveugle, à veiller sur un unique pied de maïs. Dès lors, pour l'aïeul comme pour la bête, chaque jour vécu sera une victoire sur la mort. Ce livre est d'une force et d'une beauté à la mesure du paysage aride, de cette plaine couronnée de montagnes dénudées où flamboie un soleil omniprésent. Le roman de Yan Lianke est un hymne à la vie. La fragilité et la puissance de la vie, et la volonté obstinée de l'homme de la faire germer, de l'entretenir, d'en assurer la transmission. C'est un acte de foi, aux confins du conte et du chant, à la langue entêtante, comme jaillie de la nuit des temps ou des profondeurs les plus intimes de l'être. (N’ayant pas lu cet ouvrage, nous nous référons au résumé qui en est donné par l’éditeur français.)
Trad. du chinois par Brigitte Guilbaud, Arles : Editions Philippe Picquier, 2009.
- 褐色桎梏 (Carcan de terre), 天津市 : 百花文艺出版社
He si zhi gu, Tianjin shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1999
Cette série d’essais illustre à la perfection l'ancrage de l'auteur et de son écriture au sein du monde rural. Dans un langage coloré et parsemé d'expressions dialectales, Yan Lianke dissèque la vie quotidienne des paysans. Il y décrit leurs peines et leurs joies, les angoisses et les espoirs d'un destin enchaîné à la terre, véritable personnage central de cette collection.
Soline Suchet
- Yan Lianke, bibliographie sélective (ouvrages primés)
- Les titres entre parenthèses sont des traductions possibles du titre chinois.
- 《黄金洞》(La grotte d’or),中国文学出版社1998年. Non traduit.
- 《朝着东南走》(En route vers le Sud-Ouest),作家出版社2000年. Non traduit.
- 《耙耧天歌》(L’hymne de Balou),北岳文艺出版社2001年. Non traduit.
- 《坚硬如水》(Dur comme l’eau),长江文艺出版社,2001年;长江文艺出版社,2004年. Non traduit.
- 《年月日》,新疆出版社2002年. Traduction française : Les jours, les mois, les années, trad. du chinois par Brigitte Guilbaud ; Arles : Éditions Philippe Picquier, 2009
- 《夏日落》(Couchant de soleil estival),春风文艺出版社,1994年.
- 《走过乡村》,新疆出版社2002年
- 《受活》,春风文艺出版社,2004年. Traduction française : Bons baisers de Lénine, trad. du chinois par Sylvie Gentil, Arles : Éditions Philippe Picquier, 2009.
- 《为人民服务》,2005 年. Traduction française : Servir le peuple, trad. du chinois par Claude Payen ; Arles : Éditions Philippe Picquier, 2006.
- 《丁庄梦》,上海文艺出版社,2006年. Traduction française : Le Rêve du Village des Ding, trad. du chinois par Claude Payen ; Arles : Editions Philippe Picquier, 2006. Rééd. trad. du chinois par Claude Payen, Arles : Éditions Philippe Picquier, 2009
- 《风雅颂》(Ballade, Hymne, Ode),江苏人民出版社,2008年. Non traduit.
Tarun J. Tejpal
La présence au Salon du Livre de Paris de l’écrivain indien, d’expression anglaise, Tarun J. Tejpal est l’occasion pour la BULAC de proposer un focus sur Loin de Chandigarh. Un roman foisonnant dans lequel son narrateur, en proie à une fascination « textuelle » et littéraire, questionne le mouvement perpétuel du désir.
La présence au Salon du Livre de Paris de l’écrivain indien, d’expression anglaise, Tarun J. Tejpal est l’occasion pour la BULAC de proposer un focus sur Loin de Chandigarh. Un roman foisonnant dans lequel son narrateur, en proie à une fascination « textuelle » et littéraire, questionne le mouvement perpétuel du désir.
Loin de Chandigarh (traduit par Annick Le Goyat, Paris, Buchet-Chastel 2008) est le roman qui a contribué à faire connaître en France Tarun J. Tejpal, journaliste et écrivain indien d’expression anglaise. Cette œuvre volumineuse foisonne de personnages secondaires qui recréent la classe moyenne indienne contemporaine comme une toile de fond sur laquelle se détache le couple passionné formé par le narrateur et son épouse. Plutôt qu’en faire un résumé, je voudrais confronter son titre original et son titre en français, chacun évoquant sous un angle différent le désir, qui est le motif principal de ce roman.
Le titre original, The Alchemy of Desire, fait référence au lien sensuel qui unit ce couple — et à cet égard le style de l’auteur n’est ni prude ni même allusif — ainsi qu’au basculement du désir qui s’opère chez le narrateur lorsqu’il devient la proie d’une fascination « textuelle » et littéraire presque morbide. Celui-ci découvre en effet, par hasard, de vieux carnets contenant le journal d’une voyageuse disparue depuis une trentaine d’années. Le lien entre texte, écriture et désir se fait plus sensible à mesure que l’on suit le narrateur dans la quête de cette femme écrivant et fantasmée. L’astuce du carnet retrouvé a beau ne pas être nouvelle, elle permet à Tarun J. Tejpal de reposer, dans un contexte contemporain, deux des questions essentielles en littérature : celle des motivations de l’écriture et celle de « l’ardeur » que suscite la lecture.
Le titre français du roman, Loin de Chandigarh, très différent en apparence, parle aussi de désir mais il met l’accent sur le mouvement, et l’inscrit dans l’espace en annonçant les divers déménagements et quêtes de logement que va vivre ce couple. Des personnages secondaires, qui vont aussi par deux, interviennent dans les tribulations des jeunes mariés qui cherchent un logement. Leur rencontre avec deux agents immobiliers qui se font fort de leur dénicher une maison à Delhi puis avec deux déménageurs qui organisent, dans un camion hors d’âge, le transport des meubles, donne lieu aux épisodes les plus amusants du roman. La ville de Chandigarh, dont est originaire l’épouse, est une création de Le Corbusier, aussi son symbolisme est-il assez clair pour les lecteurs français : ville rationnelle, elle est le pendant du petit village des contreforts de l’Himalaya où arrive finalement le couple, et où il se dissoudra. Au fil de cet itinéraire, on comprend qu’outre les difficultés quotidiennes réelles (logements chers, entassement dans les villes), c’est davantage « l’intranquillité » qui à chaque fois pousse le narrateur à vouloir s’éloigner des lieux qu’il avait pourtant choisis. Les carnets découverts contenant des récits de voyages et les deux titres de ce roman se complètent et font sens en recréant le lien intrinsèque, selon Tarun J. Tejpal, entre désir et mouvement.
Gaëlle Bidard, chef du service Asie
Tarun J. Tejpal est un auteur dont les thèmes — son succès en librairie en témoigne — ont su trouver un écho chez les lecteurs français, tout comme Vikram Seth, Amitav Gosh, Anita Desaï ou Abha Dawesar. Tous ces auteurs écrivent en anglais ; à la BULAC, nous avons déjà sélectionné plus d’une centaine d’ouvrages de littérature indienne anglophone en vue de l’ouverture de la future bibliothèque. Toutefois, le succès commercial de la littérature anglophone ne doit pas occulter l’importance de la littérature en langues vernaculaires qu’il faut ici souligner : un fonds de plus de 500 œuvres en hindi, tamoul, pendjabi, bengali... (sur lequel nous aurons l’occasion de revenir...) sera proposé au public de la bibliothèque, en libre-accès et empruntable dans sa majeure partie, à partir de la rentrée 2011.
Cotes des ouvrages de Tarun J. Tejpal (consultables à la BULAC, dès la rentrée 2011) : GEN.III.95814 et IND.D.III.964 (en français) et GEN.IV.15739 (en anglais)
Gaëlle Bidard, chef du service Asie
Ludmila Petrusevskaa
La nuit m’appartient qui est le roman « coup de cœur » de la BULAC, parmi les ouvrages de Ludmila Petrusevskaa, avait dû attendre vingt ans et la fin de l’URSS pour être enfin traduit.
Ludmila Petrusevskaa (autre orthographes : Ludmila Petrouchevskaïa, Lioudmila Petrouchevskaia), Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, 72 ans, romancière, nouvelliste et dramaturge est la représentante de la littérature russe au Salon du livre de Paris. La publication en 1972 de sa première nouvelle A travers champs [Через поля] dans la revue Avrora est suivie pour cet auteur d’une longue période de silence imposée par la censure. Il faudra attendre la fin de l’URSS et 1992 pour que son roman La nuit m’appartient [Время ночь] soit publié et traduit dans de nombreuses langues. Considérée aujourd’hui comme un auteur incontournable de la littérature russe, Ludmila Petrusevskaa et sa prose concise et incisive sont revenues sur le devant de la scène éditoriale en 2009 avec La petite fille de l’hôtel Métropole [Маленкая девочка из Метрополя]. Ce récit d’une enfance marquée par la guerre augure d’une rencontre littéraire exceptionnelle qui devrait marquer d’une pierre blanche l’Année France-Russie 2010.
S’il est parmi tous ces titres, un « coup de cœur », je pencherais pour La nuit m’appartient. Ludmila Petrusevskaa y brosse avec humour et dérision le tableau d’une Russie à l’abandon. Dans ce premier ouvrage de l’auteur traduit en français, sans méchanceté, Ludmila Petrusevskaa nous livre un personnage féminin très attachant dont la confession est le reflet peu flatteur d’une société en crise.
Laetitia Pascolini, chef du service Europe balkanique, centrale et orientale
Dans les collections de la BULAC
Notamment en français :
- La petite fille de l'hôtel Métropole, Belfond, 2009 (1 exemplaire à Clichy LIT.IV.1187 ; 1 exemplaire BULAC cote libre accès LAE 14RU 823.15 PET M)
- Cinzano, L'Age d'homme, 2003 (1 exemplaire BULAC GEN.IV.13582)
- Immortel amour, R. Laffont, 1991 (1 exemplaire LIT.III.2123 (Clichy) ; GEN.III.36589 Lille)
- La nuit m'appartient, R. Laffont, 1994 (1 exemplaire LIT.III.2268 (Clichy) ; GEN.III.43054 Lille)
En russe :
- Тайна дома, Квадрат, 1995 (PB.IV.12849 cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET T)
- Собрание сочинений в пяти томах, 1996 (1 exemplaire BULAC PBIV.13402 (1 à 5) cote libre accès LAR 14RU 823.15 PET S 1-5)
- Настоящие сказки, Вагриус, 1997 (1 exemplaire BULAC PB.III.13546- cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET N)
- Дом девушек, Вагриус, 1998 (1 exemplaire BULAC PB.III.13546- cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET D)
- Квартира Коломбины, Амфора, 2006 (1 exemplaire BULAC PB.III.16008- cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET K)
- Колыбельная птичьей родины, Амфора, 2008 (1exemplaire BULAC PB.III.16619- cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET K)
- Девятый томь, ЭКСМО, 2003 (1 exemplaire BULAC PB.III.14762)
- Дикие животные сказки, ЭКСМО, 2003 (1 exemplaire BULAC PB.III.14757)
- Два царства [рассказы, сказки], Амфора, 2007 (1exemplaire cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET D)
- Загадочные сказки Стихи(хи)² Пограничные сказки про котят Поэмы, Амфора, 2008 (1exemplaire cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET Z)
- Истории из моей собственной жизни, Амфора, 2009 (1exemplaire cote libre-accès LAR 14RU 823.15 PET I)
- Номер Один, или В садах других возможностей, Амфора, 2009 (1exemplairecotelibre-accèsLAR 14RU 823.15 PETN)
Andrei Kourkov
L’œuvre d’Andreï Kourkov est une merveilleuse introduction à l’Ukraine contemporaine. Cet écrivain majeur est un cosmopolite convaincu qui revendique le fait d’écrire en russe, sa langue maternelle. Il participera à plusieurs conférences dans le cadre du Salon du livre de Paris.
Homme à la biographie cosmopolite et aux talents multiples, Andreï Kourkov (Андрей Курков) est certainement l’écrivain ukrainien vivant le plus connu dans le monde.
Comme tout un chacun, nous l’avons découvert à la BULAC avec la traduction française du Pingouin (2000). On retrouvait dans ce roman l’atmosphère caractéristique des littératures passées par l’expérience soviétique, mélange de cocasserie et d’ironie sarcastique, d’autodérision et de mélancolie existentielle. Kourkov déployait aussi des talents de scénariste dans L’Ami du défunt (1997), qui met en scène les tribulations d’un suicidaire ne voulant plus mourir après avoir conclu un accord avec la mafia pour se faire tuer. Cette année, avec Laitier de nuit, l’auteur trace, là encore au travers de personnages burlesques et touchants, son portrait de l’Ukraine : un pays jeune et vieux à la fois, débordant de vitalité, à la pauvreté engluée dans une corruption héréditaire.
Pour le public de la BULAC, Andreï Kourkov est une merveilleuse introduction à l’étude de l’Ukraine contemporaine, dans toute sa complexité linguistique et politique. Cosmopolite, ouvert au monde, il a choisi, après avoir été traducteur de japonais et vécu plusieurs années en Grande-Bretagne, de venir vivre à Kiev, où il a pris une part active à la Révolution orange. Citoyen ukrainien né à Saint-Pétersbourg, il revendique le fait d’écrire en russe, sa langue maternelle, soutenant que celle-ci est la seule langue de communication entre les peuples d’Europe orientale. Il est aujourd’hui traduit dans une vingtaine de langues, dont bien sûr l’ukrainien. Vous trouverez dans le fonds de la BULAC, ses textes en russe et leur traduction française.
Françoise Hours, chef du département politique et développement documentaires
En français :
- Le pingouin / trad. par Nathalie Amargier. L. Levi, 2000.
- 14RU 823.15 KUR S
- Le caméléon / trad. par Christine Zeytounian-Beloüs. L. Levi, 2001.
- 14RU 823.15 KUR D
- L'ami du défunt / trad. par Christine Zeytounian-Beloüs. L. Lévi, 2002.
- 14RU 823.15 KUR M
- Le dernier amour du président / trad. par Annie Epelboin. L. Lévi, 2005.
- 14RU 823.15 KUR P / 14RU 823.15 KUR P
- Les pingouins n'ont jamais froid / trad. par Nathalie Amargier. L. Lévi, 2005. 14RU 823.15 KUR Z
- Laitier de nuit / trad. par Paul Lequesne. L. Levi, 2010.
- 14RU 823.15 KUR N
En russe :
- Бикфордов мир [Le monde de Bickford, non traduit]. M., АСТ, 2000. 14RU 823.15 KUR B
- Добрый ангел смерти [Le caméléon]. СПб, Амфора, 2006 14RU 823.15 KUR D
- Игра в отрезанный палец [Le jeu du doigt coupé, non traduit]. Харьков, Фолио, 2001. 14RU 823.15 KUR I
- Закон улитки [Les pingouins n'ont jamais froid]. СПб, Амфора, 2005. 14RU 823.15 KUR Z
- Сказание об истинно народном контролере [L’histoire du contrôleur vraiment populaire, non traduit]. СПб, Амфора, 2007. 2 exemplaires
- 14RU 823.15 KUR , 14RU 823.15 KUR G 1
- Ночной молочник [Laitier de nuit]. Харьков, Фолио, 2008. 14RU 823.15 KUR N
Dans le catalogue de la BULAC

Loin de Chandigarh

Les jours, les mois, les années
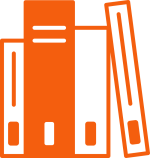
L' immeuble YacoubianImages animées

Laitier de nuit
